Améliorer les conditions d’élevage ou abolir l’élevage?
Le mouvement de défense animale est divisé par deux courants opposés : le réformisme (ou le mouvement pour le bien-être animal) et l’abolitionnisme. Alors que le premier travaille à la régulation de l’exploitation animale (dans l’optique de diminuer la souffrance infligée) sans remettre en cause la légitimité même de l’exploitation, le second revendique sans nuance son abolition pure et simple, sous toutes ses formes. Il existe aussi une troisième voie appelée le néo-welfarisme par ses opposants, mais qui pourrait aussi être appelée le gradualisme ou l’abolitionnisme réformiste. Cette dernière estime que l’abolition totale de l’exploitation animale constitue l’objectif ultime, mais qu’entre-temps des campagnes de régulation pour améliorer les conditions d’élevage sont légitimes, voire souhaitables, et que cette régulation est compatible avec l’objectif d’abolir à terme l’exploitation.
L’approche abolitionniste, inspirée largement par les travaux du professeur de droit et philosophe Gary Francione, demeure très critique envers les mesures réformistes. Je n’expliquerai pas en détails ici les raisons qui l’amènent à penser ainsi (vous pouvez par contre consulter ce billet sur son blogue ou lire le livre illustré ci-dessus), mais elles peuvent se résumer en ces deux points : réformer les conditions d’élevage rassure les consommateurs, qui sont alors moins portés à se demander si l’exploitation animale est justifiable, et les campagnes réformistes détournent des ressources qui pourraient être mieux utilisées pour revendiquer directement le véganisme et l’abolition de l’exploitation animale.
À ceux qui estiment que l’abolition est utopique, les partisans de l’approche abolitionniste répondent que cesser de faire souffrir les animaux tout en les exploitant est encore plus irréaliste, d’autant plus si on tient compte des intérêts économiques en jeu. Plutôt que d’encourager les consommateurs à se tourner vers des formes d’exploitation qui demeurent injustes et extrêmement cruelles, on peut plutôt les inviter à devenir végétaliens. Les résistances à ces changements sont davantage psychologiques et ces barrières peuvent tranquillement tomber au fur et à mesure que les gens sont mis devant le fait que le végétalisme est accessible. L’abolition de l’esclavage humain paraissait elle aussi utopique lorsque les pionniers du mouvement commençaient à la revendiquer mais, heureusement, l’utopie d’une génération peut devenir le sens commun de la suivante. Et aujourd’hui, on continue à se battre pour l’égalité entre les hommes et les femmes, et même si cet idéal demeure utopique, cela ne devrait pas nous empêcher de militer pour atteindre cet idéal.
Ce qui peut paraître surprenant est que l’approche abolitionniste s’applique également à la pratique d’avoir des animaux de compagnie, car cela n’est pas plus justifiable que les autres formes d’exploitation. En effet, les animaux de compagnie sont tout autant considérés comme des biens meubles que l’on adopte pour satisfaire nos plaisirs, ce qui s’apparente dangereusement à l’esclavagisme. En réalité, l’approche abolitionniste revendique l’extinction de toutes les espèces domestiquées : il faut prendre soin des animaux domestiqués restants (en les adoptant des refuges, par exemple), les laisser vivre une belle vie parmi nous, mais il faut à tout prix les stériliser afin de prévenir que de nouveaux animaux domestiqués viennent au monde. Abolir l’exploitation est insuffisant, car il faut aussi abolir la domestication au grand complet (car toute domestication est, de ce point de vue, de l’exploitation).
Est-ce juste? Faut-il abolir à terme le fait même de vivre avec des animaux dans nos sociétés? Y’a-t-il une alternative moralement acceptable à l’extinction des animaux de compagnie? Une nouvelle théorie de la justice animale avance qu’il peut être justifié, voire moralement souhaitable, de conserver les animaux domestiqués dans nos sociétés, mais à condition que nous leur octroyons le statut de citoyens.
L’approche de la citoyenneté
J’ai endossé l’abolitionnisme sous sa forme extinctionniste pendant quelques années, mais de nouveaux travaux sont venus bouleverser mes convictions. Au cours de l’été 2012, j’ai fait la connaissance de l’approche de la citoyenneté proposée par Sue Donaldson et Will Kymlicka dans leur livre Zoopolis. Cet ouvrage propose une approche politique à la question des droits des animaux. Selon ces auteurs, les animaux domestiqués doivent être reconnus en tant que citoyens de nos sociétés, alors que les animaux sauvages devraient être considérés comme formant des communautés souveraines; les animaux limitrophes, vivant dans nos cités mais n’étant pas domestiqués, pourraient recevoir le statut de résidents permanents. Dans les trois cas, cela altère certains des devoirs positifs que nous avons à leur endroit (c’est-à-dire, quelle aide ou quel support nous devons leur apporter); cela ne change donc pas que tous les animaux, peu importe leur type relation avec nous, méritent de recevoir des droits négatifs fondamentaux (droit à ne pas souffrir, droit à ne pas être tué, droit à la liberté).
Considérer les animaux domestiqués comme étant des citoyens peut sembler risible aux yeux de plusieurs. Après tout, les animaux domestiqués ne peuvent participer à la vie politique! Ou, du moins, c’est qu’ils ne le font pas de la même manière que nous. Ce dont les animaux domestiqués sont capables, en revanche, est de participer à la vie sociale avec nous, de communiquer avec nous et d’exprimer leurs besoins et de négocier certaines règles du vivre-ensemble, en plus de pouvoir coopérer avec nous (sans quoi, ils ne seraient pas domestiqués). Or, toutes ces choses devraient être pertinentes du point de vue politique. De plus, les animaux domestiqués ont été entraînés parmi nous (bien souvent de force) et ils contribuent à notre société (bien que cela se produise actuellement dans la plus grande violence). Pour toutes ces raisons, il convient de leur reconnaître un statut de membres à part entière de nos sociétés.
Lors d’une conférence à Philopolis 2013, Christiane Bailey et moi-même avons présenté les grandes lignes de ce projet de citoyenneté appliqué aux animaux domestiqués. Comme le but de ce présent billet n’est pas de détailler cette théorie, vous pouvez consulter en attendant mon diaporama de présentation sur Academia.edu (bien qu’il ne s’agisse pas d’un texte continu contenant tous les détails et les arguments) et lire ce compte-rendu critique de Christiane.
Critiques de l’abolitionnisme-extinctionnisme
Donaldson et Kymlicka m’ont convaincu qu’on ne pouvait exclure à priori toutes les relations avec les animaux domestiqués. Les arguments généralement évoqués par les abolitionnistes-extinctionnistes comme Francione (voir par exemple ici) et Dunayer (une autre abolitionniste) ne sont pas suffisants en soi pour justifier la fin de toutes relations avec les animaux domestiqués (voir Zoopolis, chapitre 4 section 3). Par exemple :
Ce n’est pas naturel (ou les animaux ne sont pas « faits » pour vivre parmi nous): Premièrement, ce serait un sophisme naturaliste de penser que parce qu’une chose n’est pas naturelle, celle-ci n’est pas désirable ou acceptable. Deuxièmement, simplement croire que « parce qu’un individu n’est pas humain, il ne peut vivre parmi les humains » serait spéciste. Troisièmement, les animaux sauvages, tout comme les espèces domestiquées, sont capables de former des relations saines qui défient la barrière des espèces. Si eux en sont capables (sans que ce soit artificiel), pourquoi serions-nous absolument incapables d’en faire autant?
La domestication fut injuste: En effet, il existe de nombreuses raisons de croire que la domestication des animaux s’est produite dans une grande violence ou, à tout le moins, que cela ne fut pas à l’avantage de l’écrasante majorité de ces individus. Francione affirme ainsi qu’il n’y a aucun sens à penser que perpétuer une chose injuste puisse être juste. Le problème est que cet argument ne distingue pas le processus et l’origine de la domestication (qui eux furent injustes) du fait de la domestication. (Zoopolis, ch. 4 sec. 1) La théorie de Zoopolis ne propose pas de continuer à domestiquer des animaux sauvages, mais plutôt de reconnaître que les animaux domestiqués qui sont déjà parmi nous méritent d’être reconnus comme membres de nos sociétés. De la même manière, la traite des esclaves africains fut horriblement injuste, mais cela n’implique pas que, reconnaissant cette injustice, il fallait alors empêcher les Africains de se reproduire ou les renvoyer en Afrique. Plutôt, il fallait entre autres les inclure à part entière dans la société et leur laisser le choix de rester parmi nous ou de vivre leur vie ailleurs.
Dépendance: Il est vrai que les animaux citoyens seraient dans un état de grande dépendance à l’égard de leurs concitoyens humains. Mais la dépendance en soi n’a rien d’indigne. Les êtres humains sont eux aussi dépendants tout au long de leur vie. Cet état de dépendance varie selon les différentes étapes de la vie et pour certaines personnes (comme les personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique), cet état est plus prononcé. Dans tous les cas, il convient plutôt de reconnaître que nous sommes en fait interdépendants. Ce qui est problématique n’est pas le fait d’être dépendant des autres, mais de comment notre société gère cette dépendance. Par exemple, il est essentiel de créer des structures pour que les gens puissent s’épanouir et faire leurs propres choix malgré leur état de dépendance, et non d’être exploités ou manipulés pour servir les autres; de plus, il est important de créer des options de sortie pour les animaux citoyens qui préfèrent ne pas rester dans nos sociétés.
Infantilisation (ou néoténie): Au cours de la domestication, les animaux ont acquis des traits qui leur donnait un air plus enfantin et doux à l’âge adulte : baisse d’agressivité, apparence physique plus juvénile, plaisir à jouer et curiosité à explorer. Certains abolitionnistes-extinctionnistes s’inquiètent ainsi que les animaux de compagnie demeurent dans un état perpétuel d’enfance, ce qui serait encore une fois indigne. Pourtant, même s’il est répréhensible de continuer à traiter un adulte comme un enfant, il faut aussi savoir que ce processus de néoténie est à l’oeuvre chez des espèces sauvages (comme les bonobos) et même chez l’être humain. Il n’y a rien de mal à ce que des adultes continuent à avoir du plaisir à jouer, qu’ils soient moins agressifs et qu’ils soient curieux.
Si l’on veut réfuter le projet de citoyenneté envers les animaux domestiqués, il semble qu’il faudra le faire au moyen d’autres arguments. Par exemple, il se peut que nos sociétés se révèlent incapables de protéger la vulnérabilité des animaux citoyens et que le fait de les garder parmi nous conduise inéluctablement à des formes d’exploitation. Ou sinon, on est en droit de se demander si l’institution actuelle des animaux de compagnie respecte vraiment leur autonomie et leur liberté, ou en d’autres mots leur capacité à faire des choix. À mon avis, si les animaux deviennent des citoyens, la relation avec les animaux de compagnie devra être radicalement différente.
En attendant, la théorie de la citoyenneté a l’avantage de reconnaître que des relations avec les animaux sont en quelque sorte inévitables et qu’il faut alors un cadre politique pour pouvoir les accueillir. Si on considère réellement les animaux comme des égaux, alors les animaux faisant partie de nos sociétés méritent d’y être inclus à part entière. En fait, ce n’est pas plus « notre » société que celle des animaux domestiqués. Ici, c’est chez eux! Nous habitons déjà dans une société mixte d’humains et d’animaux non humains. Ce qui est injuste ne serait pas tant le fait qu’ils soient parmi nous que le fait qu’ils soient systématiquement considérés comme des machines destinées à nous servir ou comme des subalternes ou des esclaves.
Distinguer deux types d’abolitionnisme
Je continue de me réclamer abolitionniste du fait que l’abolition de l’exploitation (des humains et des animaux non humains) demeure une nécessité morale, mais cela ne signifie pas que je voudrais nécessairement abolir toutes les relations entre les humains et les animaux non humains. Cette nuance est très importante : dans le cas humain, nous dressons une distinction entre l’exploitation et la coopération. L’exploitation représente une violation des droits de l’exploité, ce dernier ne pouvant plus contester sa situation et encore moins y mettre fin. La coopération, par contraste, se veut mutuellement bénéfique, ce qui implique que chaque parti a une voix égale à la co-création de la relation en question et qu’il ne doit pas y avoir de domination arbitraire de l’un sur l’autre. Pourquoi cela ne pourrait pas s’appliquer aux animaux domestiqués, qui sont par définition capables de coopérer avec nous?
La raison qui nous invite à demeurer sceptiques est que la condition de « mutuellement bénéfique » est très périlleuse, car elle a traditionnellement été instrumentalisée pour justifier l’exploitation des plus faibles (humains et non humains). Un projet de saine cohabitation avec les animaux est donc très risqué, d’autant plus que les animaux citoyens ne sont pas capables par eux-mêmes de rapporter les injustices dont ils sont victimes. La tendance des êtres humains à exploiter, manipuler et dominer les plus faibles — y compris parmi les siens — est particulièrement forte. Cependant, les défis qui attendent la citoyenneté animale ne sont pas propres aux animaux domestiqués, mais concernent le statut de tout groupe vulnérable. C’est pourquoi j’estime que ce n’est pas un obstacle insoluble et qu’il faudra faire de plus en plus de ponts avec les différents mouvements sociaux et les causes de justice sociale afin d’apprendre comment mieux instituer la protection et l’égalité des animaux citoyens.
Et c’est bien seulement si nous nous révélons incapables d’assurer le bien-être, l’épanouissement et les droits des animaux citoyens qu’il faudra alors abolir toutes nos relations avec eux. En attendant, une chose est sûre : leur exploitation est injustifiable, et à cet égard, les partisans des deux approches peuvent collaborer pour y mettre fin.

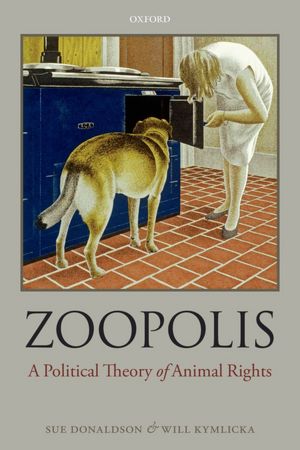
Ping : Qu’est-ce que la justice animale? | Frédéric Côté-Boudreau
C’est très intéressant et je crois qu’il est important de réfléchir séparément à la question des animaux « de compagnie » par rapport aux animaux où il n’y a pas d’affection réciproque mais seulement l’exploitation d’une espèce sur une autre.
Merci pour cet article qui m’aide à y voir plus clair.
Il y a évidemment des exceptions, mais j’ai l’impression que la plupart des espèces domestiquées ont quand même une tendance à faire confiance à l’être humain, et en particulier si on les enlève dans un environnement qui tient compte de leurs besoins et particularités et où on les traite comme des individus. C’est un peu parfois elles ont été domestiquées, c’est parce qu’elles peuvent se montrer capables de coopérer avec nous. Le problème est que nous avons abusé de leur confiance et que nous les traitons comme des biens pour nous servir. Mais dans un cadre où on les traite comme des égaux, on peut assister à l’éclosion de relations d’affection réciproque.
On le voit par exemple dans le cas d’Esther le cochon: https://www.facebook.com/estherthewonderpig
Ou dans les images de sanctuaires d’animaux. Les animaux d’élevage sont capables de s’attacher à nous tout comme nous pouvons nous attacher à eux lorsqu’on s’y donne la peine.
Merci pour votre intervention, et si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser afin que je fasse d’autres billets sur ce thème!
Ping : Lorsqu’il est impossible d’être végétalien | Frédéric Côté-Boudreau
Ping : Peut-on (et doit-on) inclure les animaux dans la philosophie politique? | Frédéric Côté-Boudreau
Bonjour,
Je découvre votre article et il répond à certaines interrogations que j’ai vis à vis des trois chats qui partagent ma vie. Je n’aime pas dire que je suis leur propriétaire, car ils font vraiment partis de notre famille, ils sont des amis, des compagnons de vie, mes enfants chats. Mais malgré l’affection réciproque que nous nous manifestons, je me pose parfois la question de la pertinence et de la justice du mode de vie que je leur impose. Ils vivent en appartement et n’ont accès qu’au balcon. Parfois je me dis qu’ils sont dans une prison dorée. Je suis étonnée de lire que les abolitionnistes sont pour la stérilisation de masse des espèces domestiquées, le but étant forcément l’extinction. J’y vois une sorte de génocide animal programmé à des fins eugénistes pour les espèces sauvages et je trouve cela assez dérangeant moralement.
En tout cas, merci de partager vos travaux et articles.
Bonjour,
Merci pour votre message. Je suis d’accord que le terme propriétaire est problématique — j’en ai même discuté dans un précédent billet et proposé d’autres alternatives. Et je compte écrire un autre billet sur la justice à l’égard des animaux de compagnie, en abordant certains problèmes que vous mentionnez.
Attention, aussi: ce ne sont pas tous les abolitionnistes qui souhaitent la stérilisation de masse de tous les animaux domestiqués. On peut revendiquer l’abolition de l’exploitation animale tout en militant pour l’inclusion sociale des animaux en tant que membres égaux de nos sociétés, comme je l’ai laissé entendre ci-haut. Je continuerai d’écrire au sujet de ce que ça implique, si ça vous intéresse!
Un grand merci pour la clarté proverbiale de cet article, j’aime tant lire vos travaux, ça m’aide immensément à articuler ma réflexion sur ces sujets assez épineux ! J’aimerais tant pouvoir suivre vos cours à Montréal.
Petite remarque en passant : le lien « diaporama de présentation sur Acadomia » n’a pas fonctionné pour moi (« erreur 404 – page not found »).
Merci d’avoir de m’avoir mentionné cette erreur, je viens de corriger en ajoutant un lien à jour! Et merci beaucoup pour vos commentaires très encourageants sur mon travail, c’est très apprécié :-)